Pour la première fois, un réalisateur a reçu l’autorisation de pénétrer dans le couvent de Notre-Dame de Bonneval, au cœur de l’Aveyron. Entre ces murs presque millénaires, il rencontre les sœurs de ce couvent et partage leur quotidien. Si au départ, le contact est difficile, il lie une relation particulière avec certaines d’entre elles. Ces dernières, ainsi que le chocolatier employé par le couvent, se livrent dans des discussions parfois surprenantes entre vérité, sourire et intériorité.
En toute honnêteté, la perspective d’entrer le temps d’un film dans un couvent et d’écouter parler des sœurs ne m’enchantait guère. Je suis un mécréant assumé. J’admire l’imagination débordante des religions modernes pour interpréter le monde et produire ou inspirer des œuvres incroyables. Mais bon, en ce qui concerne la foi, je suis dubitatif face à leur « vérité », c’est comme ça. Donc au départ, c’est avec une certaine appréhension que je m’apprêtais à passer 77 minutes d’un enfer terrestre peuplée de gentilles dames de 94 ans m’expliquant leur foi et le pourquoi du comment il fallait croire pour sauver son âme…
Et pourtant, malgré des défauts que j’évoquerais plus bas, ce film n’a pas arrêté de me surprendre positivement. Surpris par le témoignage de ces femmes rayonnantes d’une spiritualité apaisée dépassant largement le cadre étriqué de la religion. Le film tire toute sa force et son intérêt de leur présence. Sur les 26 sœurs peuplant ce couvent, elles ne sont que quelques une à apparaître devant la caméra (dont la mère supérieure). Évoquant tour à tour leurs rapports avec la société contemporaine, leur famille ou la notion très relative de liberté, elles possèdent une liberté de ton vraiment déstabilisante loin des clichés dont j’étais moi-même prisonnier. Durant plus d’une heure, on s’émeut, on s’interroge, on sourit aussi devant ce dialogue entre elle et la caméra. Derrière l’austérité du lieu et l’image sombre du convent, on découvre une humanité cachée débordante de vie qui met à mal nos certitudes.Cependant, si le film tire sa force des témoignages des sœurs, il n’en demeure pas moins limité sur quelques aspects de la réalisation. On ressent par exemple le manque chronique de temps. Sur ce point, le film porte bien son nom. La première image présente le couvent dans un plan d’ensemble. Niché au cœur d’une vallée, entouré par la forêt et les montagnes, ce lieu est enchanteur, hors d’âge et hors du monde. C’est une promesse d’un rapport particulier entre les habitantes et cet espace. Ce lieu forge aussi la communauté. Mais cette idée ne sera que très peu exploitée à l’image. Comme si le réalisateur ne s’était focalisé que sur cette parole par peur de rater, de manquer de temps. Ainsi, il n’épouse pas le projet dans son ensemble, n’inscrit pas cette communauté dans la continuité historique (le couvent existe depuis presque un millénaire) mais uniquement dans un présent. Frustrant pour le spectateur qui ne fait qu’entr’apercevoir ce lien.
Ensuite, le choix du réalisateur est d’intervenir uniquement via des panneaux noirs entrecoupant et rythmant les scènes. Il faut lui rendre hommage sur ce point, il ne cache pas les difficultés rencontrées durant le tournage, en particulier le refus de certaines sœurs d’être filmées. C’est une vraie confiance dans son spectateur. Cependant, si les premiers apportent une certaine information sur son état d’esprit, les suivants parasitent un peu le déroulement du film, « surcoupant » certains passages.
En conclusion, même s’il souffre de quelques petits défauts qui auraient pu le rendre incontournable, ce film tranche avec l’image habituelle et rend un bel hommage à ces religieuses. Loin de toute forme de prédication, Le temps de quelques jours est tourné au rythme tranquille de ces femmes qu’on peut admirer pour leur spiritualité positive, loin des heurts du monde. En filigrane, un message de tolérance qui appelle à une réflexion sur soi-même. Sur ce point, ce film est une réussite.
La bande annonce :
Le temps de quelques jours
Réalisation : Nicolas Gayraud
Durée : 77′
Production : La Vint-Cinquième heure, 2014
Edition DVD : Editions Montparnasse, 2015
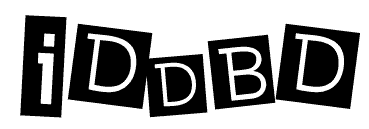


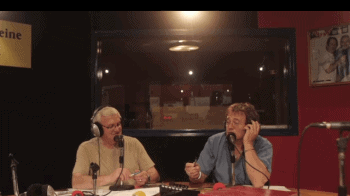 Parfois, on reproche au cinéma documentaire de n’aborder que des thèmes négatifs : guerre, chômage, violence, mal de vivre… Si ce cinéma se nourrit en partie des difficultés du monde il sait, au détour d’une séance, nous faire également découvrir des films de qualité au sujet plus légers. Ainsi, Silence Radio plonge le spectateur dans la réalité d’une petite radio tenue par une armée de bénévole mais aussi, et c’est là tout l’intérêt de la démarche de Valéry Rosier, dans le quotidien de ceux qui les écoutent. Pour montrer ce double visage, le réalisateur belge propose un montage dynamique tout en équilibre entre plans filmés à la radio et lieux d’écoute (salons, salle de bains, voitures…) avec toujours ce souci de placer l’humain et son environnement au centre de l’écran. En fil rouge de cette aventure cinématographique, les sons de Radio Pusaleine et une bande originale de référence dans le genre (je suggère au producteur d’éditer la BO, je pense que ça devrait marcher.
Parfois, on reproche au cinéma documentaire de n’aborder que des thèmes négatifs : guerre, chômage, violence, mal de vivre… Si ce cinéma se nourrit en partie des difficultés du monde il sait, au détour d’une séance, nous faire également découvrir des films de qualité au sujet plus légers. Ainsi, Silence Radio plonge le spectateur dans la réalité d’une petite radio tenue par une armée de bénévole mais aussi, et c’est là tout l’intérêt de la démarche de Valéry Rosier, dans le quotidien de ceux qui les écoutent. Pour montrer ce double visage, le réalisateur belge propose un montage dynamique tout en équilibre entre plans filmés à la radio et lieux d’écoute (salons, salle de bains, voitures…) avec toujours ce souci de placer l’humain et son environnement au centre de l’écran. En fil rouge de cette aventure cinématographique, les sons de Radio Pusaleine et une bande originale de référence dans le genre (je suggère au producteur d’éditer la BO, je pense que ça devrait marcher.  Grâce à ce procédé, nous sommes immédiatement frappés par ce lien fort qui unit les deux groupes : lL’un derrière le micro, l’autre derrière son poste de radio. Dans les grésillements d’un matériel d’émission à la dérive (lâchera, lâchera pas ?), la vie des uns et des autres est marquée par les appels téléphoniques à la station, les dédicaces et la musique française gentiment désuète de ces « années-là ». Car Radio Puisaleine n’est pas une radio de « djeun’s », ni même une radio libre version année 80, mais plutôt, à l’image de ses animateurs et de ses auditeurs, une élégante vieille dame qui propose des moments d’amitiés, d’écoutes et de partages. Une radio de proximité pour âme seule.
Grâce à ce procédé, nous sommes immédiatement frappés par ce lien fort qui unit les deux groupes : lL’un derrière le micro, l’autre derrière son poste de radio. Dans les grésillements d’un matériel d’émission à la dérive (lâchera, lâchera pas ?), la vie des uns et des autres est marquée par les appels téléphoniques à la station, les dédicaces et la musique française gentiment désuète de ces « années-là ». Car Radio Puisaleine n’est pas une radio de « djeun’s », ni même une radio libre version année 80, mais plutôt, à l’image de ses animateurs et de ses auditeurs, une élégante vieille dame qui propose des moments d’amitiés, d’écoutes et de partages. Une radio de proximité pour âme seule.  Dans cet émouvant portrait, Valéry Rosier est comme le petit-fils taquin de cette vieille dame : il l’aime bien et apprécie de la chahuter un peu. Ainsi, on rit avec tendresse devant des conversations improbables, des entretiens radiophoniques d’un autre âge ou des couacs techniques qui feront pâlir les professionnels. Mais voilà, il y a tellement de belles volontés qu’invariablement on s’attache à ces gens-là. Personnellement, je retrouve dans ces bénévoles radiophoniques les mêmes petits écarts, les mêmes petits défauts et surtout la même énergie que chez les bénévoles de bibliothèques. Au final, un film sympathique à la réalisation très propre qui vous mènera dans le petit monde de la radio associative, dans la nostalgie des chansons d’antan, dans un univers en décalage… un petit peu de simplicité dans un monde complexe. Un peu de bonheur quoi ! A noter que ce film a reçu le FIPA documentaire 2013. A écouter (en streaming) : Radio Pusaleine évidemment ! A lire :
Dans cet émouvant portrait, Valéry Rosier est comme le petit-fils taquin de cette vieille dame : il l’aime bien et apprécie de la chahuter un peu. Ainsi, on rit avec tendresse devant des conversations improbables, des entretiens radiophoniques d’un autre âge ou des couacs techniques qui feront pâlir les professionnels. Mais voilà, il y a tellement de belles volontés qu’invariablement on s’attache à ces gens-là. Personnellement, je retrouve dans ces bénévoles radiophoniques les mêmes petits écarts, les mêmes petits défauts et surtout la même énergie que chez les bénévoles de bibliothèques. Au final, un film sympathique à la réalisation très propre qui vous mènera dans le petit monde de la radio associative, dans la nostalgie des chansons d’antan, dans un univers en décalage… un petit peu de simplicité dans un monde complexe. Un peu de bonheur quoi ! A noter que ce film a reçu le FIPA documentaire 2013. A écouter (en streaming) : Radio Pusaleine évidemment ! A lire : 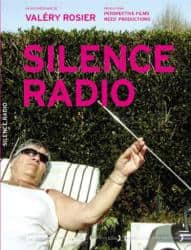 Silence Radio Réalisateur : Valéry Rosier Durée : 52′ Productions : Need Productions / Perspective films Année de production : 2013
Silence Radio Réalisateur : Valéry Rosier Durée : 52′ Productions : Need Productions / Perspective films Année de production : 2013